Luc Briand, Le brassard, Plein Jour, 2022, 19€
Le cas Villaplane est aujourd’hui bien connu de l’historiographie, mais il n’avait pas encore eu droit à un récit détaillé. C’est désormais chose faite grâce à Luc Briand et aux éditions Plein Jour.
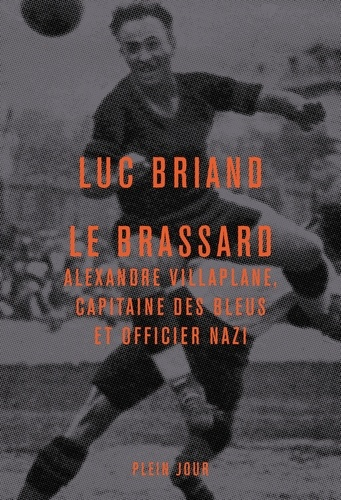
L’auteur, magistrat de formation, s’est livré à un remarquable dépouillement des archives qui permet au récit de dépasser le cadre de la biographie romancée et de s’inscrire ainsi comme une véritable œuvre d’histoire. Certes, parfois le lecteur hésite et se demande ce qui relève de la fiction ou de la réalité, mais l’ensemble se lit avec plaisir et offre de précieuses informations.
Ne se contentant pas d’écrire une biographie de Villaplane, Luc Briand éclaire aussi, par moment, le contexte global de l’époque. A travers le parcours du footballeur international devenu gestapiste, se dévoilent donc des pans de l’amateurisme marron, des débuts du professionnalisme, de l’Occupation.
A côté de Villaplane, des personnages secondaires se font aussi jour. L’auteur met ainsi en parallèle les destinées contraires de Villaplane et d’Etienne Mattler, footballeur international devenu résistant. Les avanies ultérieures du Conte Verde, paquebot qui conduisit les joueurs de l’équipe de France en Uruguay en 1930, sont aussi contées. Les agissements de Bonny et Lafont, chefs de la Carlingue, sont mis en lumière.
Bref, c’est un récit complet et intéressant que propose Luc Briand. En particulier, il se montre brillant lorsqu’il donne dans la chronique judiciaire et a le bon goût d’épargner au lecteur de vaines explications psychologiques au moment de décrire les glissements successifs de Villaplane, de joueur de football à criminel puis à collaborateur actif avec l’occupant. Plutôt que de spéculer, l’auteur serre alors les archives. C’est tout à son honneur.
Note : 3/5
Fabien Archambault, Coups de sifflet, Flammarion, 2022, 18€
Sorti opportunément quelques semaines avant le début de la Coupe du monde au Qatar, ce petit livre de Fabien Archambault entreprend de relier l’histoire du football à celles de la mondialisation et de la modernité. Structuré en 11 récits indépendants, il permet de voir le football conquérir le monde.
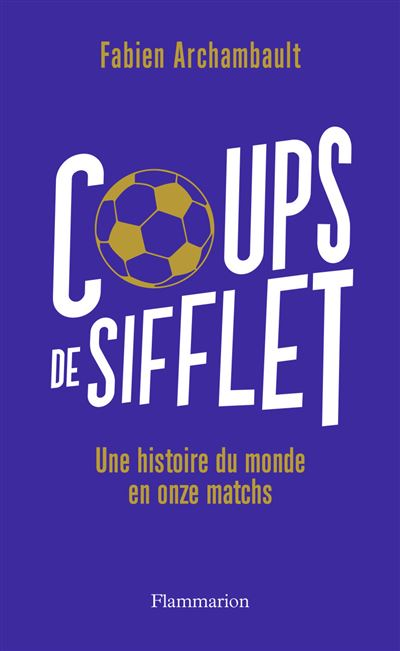
Ainsi, s’inscrivant dans un long XXe siècle (1870-1998), l’ouvrage dépeint d’abord l’enracinement du football comme sport d’hiver en Grande-Bretagne. Puis on voit le football être le support des revendications indépendantistes ou autonomistes en Inde. On assiste aussi à son développement dans l’espace danubien (Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie), en URSS, en Allemagne, en France. Le rayonnement mondial de la figure de Pelé est étudié, tout comme la mise en place de derbies (notamment à Glasgow, Rome, Milan ou Turin).
Spécialiste de l’histoire du football en Italie, Fabien Archambault est évidemment le plus intéressant lorsqu’il aborde ce pays, notamment les rapports entre Pasolini, le PCI, la gauche intellectuelle et le football. Mais les remarques sur le rôle du football en RDA, essentiellement à travers la rencontre avec la RFA en 1974, sur le miracle de Berne ou sur les matchs de propagande organisés à Leningrad pendant le siège sont aussi fort intéressantes.
Néanmoins, c’est sans doute le chapitre consacré à la Coupe du monde en Uruguay qui marque le lecteur. S’appuyant sur la récente thèse que Lorenzo Jalabert D’Amado a consacrée à la compétition, Fabien Archambault propose une histoire précise et actualisée de la première Coupe du monde. Si tout le chapitre est magnifique, les dernières lignes méritent d’être citées in extenso tant elles sont justes et montrent l’importance de l’Amérique du Sud dans le succès de la Coupe du monde : « que ce soit dans la joie ou dans le chagrin, l’intensité des émotions provoquées par les Coupes du monde de football indique la centralité de celles-ci dans les systèmes symboliques des sociétés sud-américaines. En comparaison, les éditions organisées en Europe jusque dans les années 1960 font pâle figure, au point qu’on s’y interrogeait même sur la viabilité de l’épreuve. Rien de tout ça, bien au contraire, en Amérique du Sud, qui voyait dans cette compétition le moyen de se mesurer avec le Vieux Continent et de traiter d’égal à égal avec lui. Ce sont bien les nations sud-américaines qui, parce qu’elles en éprouvaient un besoin impérieux, créèrent la Coupe du monde de football et réussirent à l’installer dans le paysage sportif mondial. »
Très stimulant et bien écrit, l’ensemble souffre tout de même de quelques limites. Tout d’abord, l’approche par touches impressionnistes manque certainement de cohérence et ne garantit pas un traitement global de la question. Sous-titré « une histoire du monde en onze matchs », le livre n’aborde ainsi jamais l’Amérique du Nord, l’Afrique et l’Océanie. L’Asie n’a le droit qu’à une seule occurrence, l’Amérique du Sud à deux. L’Europe se réserve donc le gros du propos.
Ensuite, chaque chapitre est assez court. Heureusement, une petite, mais fort précieuse et à jour, bibliographie en fin d’ouvrage permet de creuser chaque thème. Pour cela, le lecteur peut remercier chaleureusement Fabien Archambault !
Note : 4/5
Dimitri Manessis et Jean Vigreux, Rino Della Negra footballeur et partisan, Libertalia, 2022, 10€
Directement édité au format poche, le livre des historiens Dimitri Manessis et Jean Vigreux revient sur le parcours tragique de Rino Della Negra, footballeur et résistant, figure mémorielle majeure du Red Star.
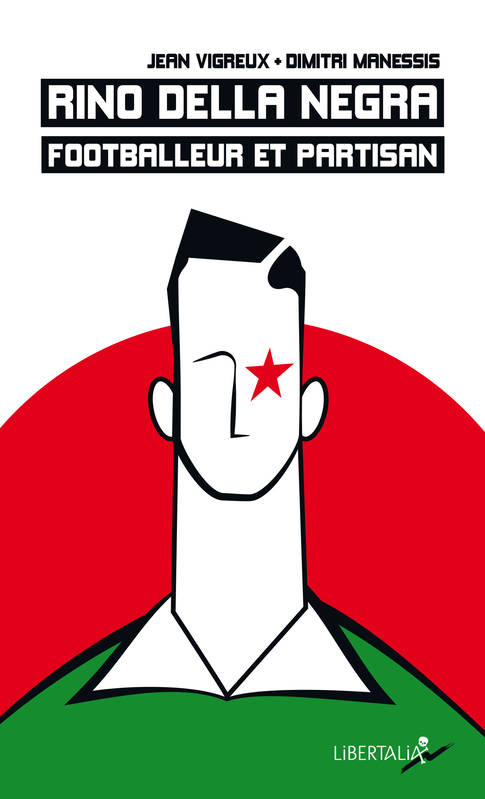
Dépassant le cadre strict de la biographie sportive, le livre s’inscrit aussi comme un morceau d’histoire sociale éclairant l’histoire et les mémoires de la Résistance, de l’immigration, des cultures communistes.
A travers Della Negra, c’est donc un pan de l’histoire du groupe Manouchian et de sa répression qui s’éclaire, c’est un instantané de l’immigration italienne en France et de la ville d’Argenteuil qui s’offre au lecteur, ce sont enfin des enjeux mémoriels anciens et immédiats qui sont mis en lumière.
L’ensemble, fondé sur un important dépouillement d’archives (publiques et privées) et sur une solide bibliographie, constitue un bon travail d’historiens. Il s’appuie aussi sur 30 photos et reproductions de documents d’époque rassemblés en fin d’ouvrage.
Néanmoins, lorsque la documentation manque, les auteurs sont parfois réduits à des hypothèses qui n’apparaissent pas incontestables. Ainsi en est-il de la volonté de faire de Rino Della Negra un antifasciste et un résistant dans l’âme, bien avant que son engagement ne soit attesté.
Certes, de cette façon, Manessis et Vigreux entendent répondre, à près de 80 ans de distance, à la propagande allemande et vichyste qui fit de Della Negra un simple footballeur apolitique, piégé presque à son corps défendant dans une sale affaire.
Ainsi, affirment les historiens, si aucun témoignage ni document n’atteste l’engagement politique de Rino Della Negra avant qu’il ne devienne réfractaire au STO en février 1943 puis s’engage dans les FTP-MOI, « il n’en demeure pas moins que sa culture politique est marquée par l’antifascisme, l’horizon de solidarité et d’émancipation d’Argenteuil et du Front populaire. »
Les parents de Della Negra furent-ils antifascistes ou résistants ? Non, mais l’« atmosphère » dans laquelle vivait le jeune footballeur à Argenteuil l’aurait conditionné à devenir résistant : « son acculturation à la cause antifasciste et patriote est alors un processus cumulatif d’imprégnation qui éclate au moment de sa convocation au STO. »
Note : 4/5

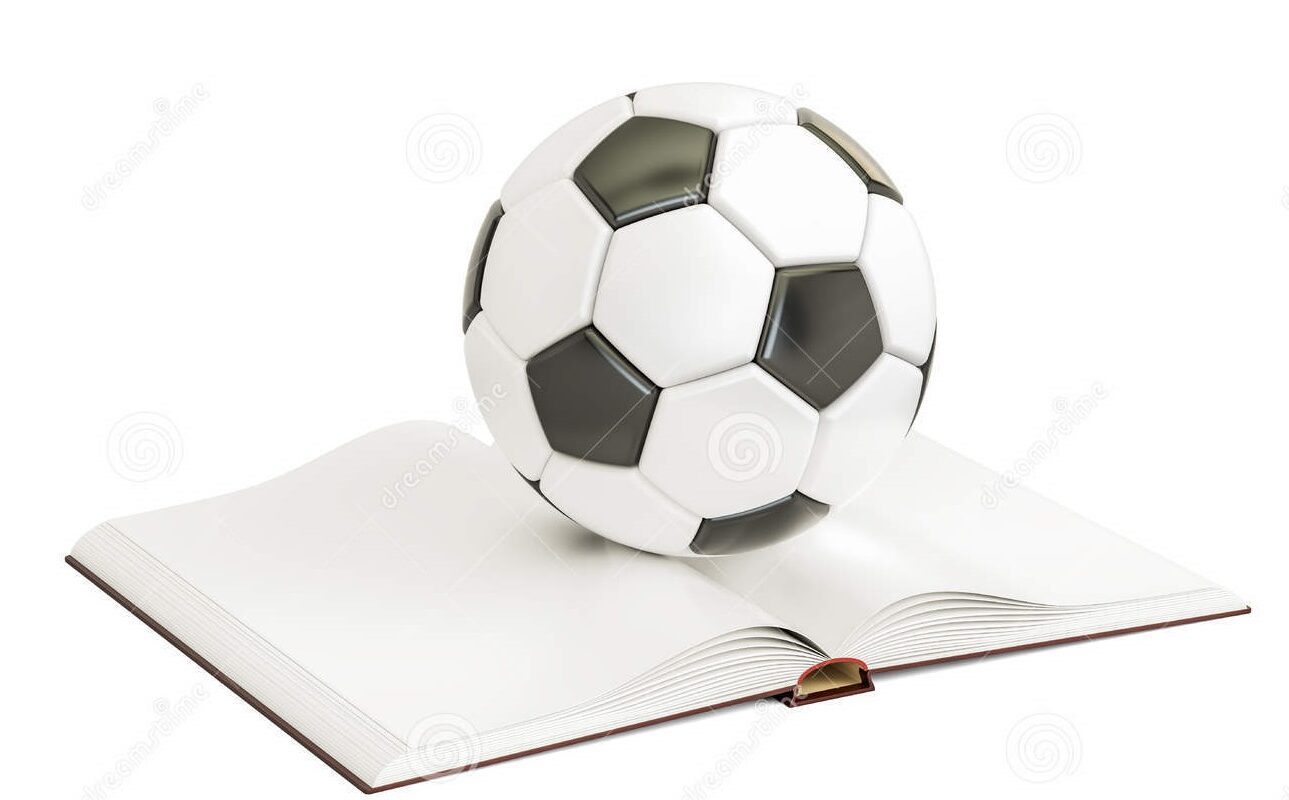

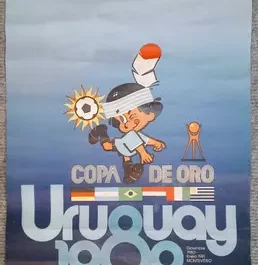

L’affiche rouge de Ferre
https://youtu.be/1nqyPVPDtcY
Le texte d’Aragon
Vous n’avez réclamé ni gloire ni les larmes
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servis simplement de vos armes
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L’affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents
Tout avait la couleur uniforme du givre
À la fin février pour vos derniers moments
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses
Adieu la vie adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan
Un grand soleil d’hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le coeur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient le coeur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant.
Un autre texte d’Aragon sublime
EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT
Tout est affaire de décor
Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c’est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m’éparpille
Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles
Où j’ai cru trouver un pays.
Cœur léger cœur changeant cœur lourd
Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes nuits
Que faut-il faire de mes jours
Je n’avais amour ni demeure
Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur
Je m’endormais comme le bruit.
C’était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table
On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d’épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent
Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Elle avait un cœur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel
Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages
Il y volait des oies sauvages
Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faïence
Elle travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent
Louis Aragon, Le Roman inachevé
La version de Marc Orgeret
https://youtu.be/x_c-vMFLVhI
Merci, Bobby!
Déjà lu Archambault (l’une ou l’autre publications en ligne), je l’avais trouvé des plus intéressants, et son style effectivement très agréable.
Chouette d’apprendre qu’il soit sorti (ou sorte enfin?) de la confidentialité de la recherche académique.
Belle fournée, ça me donne envie de lire celui sur rino della negra!
On attend donc que tu nous en livres prochainement tes impressions.
Ouhlala.
K