La Coupe Gambardella souffle ses 70 bougies cette année. Ce trophée prestigieux, ainsi nommé en l’honneur de l’ancien président de la Fédération, Emmanuel Gambardella, mort en 1953, est un patchwork d’épopées et de naufrages sans cesse renouvelés qui mériterait assurément l’intégralité d’un ouvrage ! A défaut de ce travail titanesque, nous vous proposons humblement quelques courtes vignettes, quelques bouts de chemins et d’espoirs qui font le sel de cette compétition. Ce sont les 30 glorieuses. 30 comme le nombre de clubs différents à l’avoir remportée. Bonne lecture !
Les pionniers

Pour tout gamin ayant découvert notre sport dans les années 1990, la formation cannoise rappelle instinctivement de grands souvenirs. Zidane, Micoud, Vieira ou Sébastien Frey, des promesses suivies d’actes qui émerveilleront le foot français pendant de longues années. En ce qui concerne l’épreuve qui nous intéresse aujourd’hui, les familiers de la Croisette d’après-guerre n’ont pas à rougir de la comparaison puisqu’ils remportent la première édition, en 1955, aux dépens du LOSC. Une édition uniquement réservée aux juniors des clubs professionnels. Si aucun joueur n’a réellement explosé au plus haut niveau, les plus physionomistes reconnaîtront Bernard Brochand, ancien cadre dirigeant du PSG et futur maire de Cannes ! Un Brochand qui eût une carrière plus que correcte entre sélections juniors et militaires.
40 ans plus tard, dans une finale délocalisée à Issy-les-Moulineaux pour cause de mauvais temps, l’AS Cannes de Guy Lacombe s’avance face au RC Lens mené par Daniel Leclercq. L’atmosphère est maussade, privée du cadre prestigieux du Parc, avec pour seule compagnie, les familles des joueurs et quelques curieux disséminés ça et là. Cannes qui, à l’époque, avait son équipe A en élite et était présent aux troisième et quatrième échelons, compte dans ses rangs Romain Ferrier, Lilian Campan, Cédric Mouret ou Patrick Barul mais l’événement principal est l’ajout de dernière minute pour la finale de Patrick Vieira qui est déjà titulaire dans les compositions de Luis Fernández en première division. Un Leclercq méfiant mise sur un bloc bas et sur la fantaisie d’un Wilson Oruma pour contrecarrer les plans des Sudistes mais doit s’avouer vaincu face aux grands compas du futur capitaine des Gunners. Le premier d’une longue série de triomphes…
La guerre de Troyes a bien eu lieu

1956 est un grand millésime pour le football aubois. L’AS Troyenne et Savinienne, club dirigé par Roger Courtois, qui alignera Pierre Sinibaldi, Abdelaziz Ben Tifour, Julien Stopyra, Pierre Flamion ou Ernst Stojaspal dans les années 1950, atteint la finale de la Coupe de France face aux sangliers sedanais. Troyes s’incline 3-1, sans qu’il n’y ait rien à redire selon leur coach : « Nous avons été pris de vitesse en première période. Les Troyens ont été trop lents et trop imprécis pour inquiéter une équipe sedanaise qui avait retrouvé son punch et sa flamme. » Si ce jour-là, les dieux de Colombes ont été cruels avec Jacques Diébold, titulaire au sein de la formation de Courtois, ils se sont montrés plus magnanimes envers Jean Diébold, capitaine de l’équipe junior lors du match de lever de rideau, quelques heures auparavant.
Les Troyens, habitués des entraînements nocturnes après leur apprentissage et leurs inévitables retours en vélo, forment une équipe excessivement jeune puisque cinq de ses membres sont encore cadets. Un groupe novice mais soudé qui défait les pronostics en battant le Stade de Reims 2-1 lors de la finale. En 1956, Troyes fut bien proche de s’offrir le premier doublé Coupe de France-Gambardella… Au-delà des Michel Artaux, le buteur décisif, de Guy Horiot l’arrière droit ou de James Muccioli l’ailier, l’histoire retiendra qu’un futur capitaine de l’équipe de France était présent du côté des vainqueurs, Marcel Artelesa. Celui qui se destinait à être maçon, surnom qui le suivra durant sa carrière, connaîtra par la suite les premiers succès monégasques, sera élu meilleur joueur du championnat 1964 et portera fièrement le brassard bleu lors du Mondial 1966. Le départ inéluctable d’Artelesa, milieu brillant par son agressivité et son abnégation, pour l’équipe professionnelle troyenne, ne perturbe pas ses anciens coéquipiers qui iront chercher une nouvelle finale l’année suivante face au RC Lens, prouvant ainsi leur indéniable qualité…
Les Ch’tis ne font pas de quartier

Le RC Lens aime passionnément la Gambardella puisqu’il est allé huit fois en finale, pour trois succès. Imitant la belle dynamique de l’équipe senior, les Sang et Or s’adjugent les éditions 1957 et 1958, permettant aux Jean Deloffre, Jean-Marie Elise et Maryan Wisniewski, son plus beau joyau offensif, de s’imposer chez les adultes, voire de participer au triomphal Mondial 1958 pour ce dernier. Il faudra attendre plus de 20 ans avant que Lens ne retrouve une finale, en 1979. Une défaite douloureuse pour les Jean-Pierre Bade et Daniel Krawczyk contre des Marseillais sans foi ni loi, suivie quatre ans plus tard d’un résultat identique face à Sochaux. Mais que pouvaient espérer Eric Dewilder et Cherif Oudjani face à la maestria de la bande de Stéphane Paille ?
Patrice Bergues remplace Jean Dombrowski à la tête du centre de formation en 1990. Pas une mince affaire puisque Dombrowski a remporté de multiples championnats cadets. A la suite d’éditions frustrantes, aux manettes d’un collectif complet (Pegguy Arphexad dans les buts, Déhu qui joue déjà pour les pros, Pierre Deblock et la terrible ligne offensive Eloi-Malm-Brunel), Bergues conduit ses troupes au titre 1992, après avoir éliminé Nice aux tirs au but et s’être joué de l’OL en finale, d’une malicieuse frappe de Robert Malm. Une consécration pour le technicien qui prendra quelques semaines plus tard la tête du symbole de l’Artois. Depuis lors, son fervent public attend patiemment des successeurs à la génération 1992 mais, en hommes de goût, les Lensois ne buteront sur la dernière marche que devant de futurs champions du Monde. Dans l’ordre, Bernard Diomède, Patrick Vieira et Kylian Mbappé…
Ici, c’est Paris !

1959, quelle année pour le club omnisports du Racing ! La section rugby remporte le bouclier grâce aux coups de casque de François Moncla et de Michel Crauste, Thadée Cisowski enfile perle sur perle, tandis que ses jeunes s’octroient la première Gambardella parisienne ! L’adversaire du jour est le Stade Malherbe, première équipe de club amateur à atteindre ce stade, qui inaugure une série malheureuse de quatre défaites en finale. Une revers au goût amer selon Raymond Decaen : « Sur les deux buts qu’on concède, il y en a un hors-jeu de deux ou trois mètres et sur l’autre il y a une main du joueur devant l’arbitre. Je crois qu’un club amateur qui aurait battu le Racing Club de Paris, ça aurait fait tâche. »
La prise de pouvoir de Lagardère dans les années 1980 est une révolution au Racing. Qualifiés pour les phases à élimination directe par la petite porte en 1987, les Hippolyte Dangbeto, Stéphane Blondeau et Sekana Diaby forment une bande de joyeux lurons qui surpasse les traquenards lillois et beauvaisien, s’entraîne régulièrement avec Francescoli et Takač et qui débarque au Stade Auguste Delaune, sûre de sa force. La finale face à Grenoble, où opère un certain Youri Djorkaeff, est âprement disputée et ne doit son dénouement qu’à un but salvateur du défenseur Dangbeto. Une bouffée d’oxygène pour ces apprentis-footballeurs, conscients que les places dans ce Matra de Galactiques se feront au compte-gouttes… Le désengagement brutal de Lagardère en 1989 change la donne, la Racing se voit obligé de sortir quelques titis de la couveuse, ira quérir la finale de la Coupe face à Montpellier, avant de disparaître définitivement des antennes nationales…
Chutes et rebonds

Comme nous l’avons vu précédemment, le LOSC a participé à la première finale de la Gambardella en 1955. Une cuvée correspondant à la Coupe de France des Jean Vincent, André Strappe et Yvon Douis, la cinquième en l’espace de neuf saisons. Cinq ans plus tard, rebelote face à l’étonnant US Quevilly ! Cette fois-ci, les partenaires d’Alain Vaillant ne laissent pas passer l’occasion mais le petit monde du football apprendra à connaître un peu mieux ces Normands rebelles… Entretemps descendus, les séniors du LOSC ne tirent pas réellement profit du succès inattendu de leurs ouailles et mettent trois ans supplémentaires à remonter dans l’élite, avant de s’embourber dans un relatif anonymat jusqu’à la fin du siècle.
Suivant l’exemple de leurs aînés, champions de deuxième division, les juniors lillois réalisent une saison 2000 aboutie. Ils sont nombreux à prendre le bus matinal passant par Tourcoing, afin de rejoindre le centre de formation, et l’ajout de l’attaquant Matt Moussilou, un temps sur les tablettes du PSG, est la dernière pièce d’un puzzle prometteur. Éliminant Nancy en demi-finale à Cherbourg, le LOSC souhaite prendre sa revanche sur son ennemi intime du moment, Auxerre, qui l’avait sorti avant la grande finale l’année précédente. Si les Bourguignons ne peuvent plus compter sur Lionel Mathis ou Djibril Cissé, Philippe Mexès est lui à nouveau sur la pelouse et va faire vivre un véritable calvaire à un Moussilou tétanisé. L’ouverture précoce du score de Leroy coupe les jambes des Lillois, il n’y aura pas de deuxième Gambardela…
Ah les crococo…

Le club gardois est un ténor de la Gambardella. Avec quatre succès, dont trois lors de la décennie 1960, Nîmes a su imposer son style inimitable, mélange de hargne et de mises à mort colorées. En 1961, le Nîmes Olympique a rendez-vous sur la Capitale. Si les séniors de Kader Firoud laissent à nouveau échapper un trophée, en s’inclinant face à Sedan, les juniors empochent le titre face à Joinville, après avoir désossé l’OL de Fleury Di Nallo, 5-1 en demi-finale. Sur sa lancée, Nîmes accumule les faits d’armes. 1966, grâce aux talents des Mézy, Iniesta, Odasso et Castro, 1969 grâce aux tripes de Bernard Boissier et de Marcel Boyron. Une jeunesse décomplexée, complètement identifiée au club et sa ville, qui devient le premier ogre de l’histoire de la Gambardella.
Précédés d’une réputation sulfureuse sur tous les terrains de Navarre, les Crocodiles se font plus discrets dans les années 1970 jusqu’à la prise de fonction du fidèle parmi les fidèles, Jeannot Bandera. Faisant fi des désirs rémois, la génération des Esclassan, Sabatier, Castagnino, Vierjon, Pupo et du carnassier Faouzi Mansouri remporte la timbale en 1977. Un quatrième titre record qui tiendra jusqu’en 1999 et un sacre auxerrois. Subissant de plein fouet la concurrence féroce de la Paillade dans la région, Nîmes ressort des abysses en 2004 et une défaite en finale face au Mans. Dernier tour de piste prestigieux pour son coach Olivier Dall’Oglio et son attaquant marocain Nabil El Zhar qui fit son bout de chemin dans la Liga. A suivre…
On est venu se qualifier pour la Coupe Gambardella !



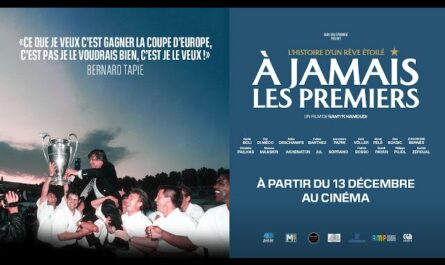

Très sympa, cette idée, chef. Jolie plongée dans le passé.
Yep, merci. On va parler de la grosse majorité des clubs historiques français. C’est ce qui fait le charme de cette compétition.
De quelle couverture médiatique cette compétition bénéficia-t-elle à son origine ? Importante, marginale ?
A une époque où les télés diffusent tout et n’importe quoi, des matchs amicaux de pré-saison sans intérêt, des tournois internationaux U17, U19 etc… chiants comme la pluie, je suis surpris que la Gambardella ne soit pas mieux couverte dans se ultimes phases
Me suis pas penché sur ce point mais on peut retrouver des images des finales, dès les années 60.
Mexes, un mec que j’aurais imaginé aller plus haut. Belle carrière mais un peu de regrets sur sa carrière avec les Bleus. Me demande toujours si j’ai joué contre lui, avant qu’il parte à Auxerre. Un peu plus jeune que moi mais des matchs face au Mirail, j’en ai fait quelqu’uns.
Des belles générations nîmoises, avec des joueurs iconiques, comme nous l’avait narré Verano dans son top.
J’aimais bien Cannes. Le retour en forme de Fernandez, Zidane, Amara Simba. Celui de Susic… Me souviens d’une grande victoire face à Fenerbahce.
Il est où Ajde pour commenter le passage lensois ? Hehe
En amour avec un ours brun, paraît-il.
Yo soy el Oso.
Je repasserai, j’aime beaucoup. Et le sujet, et ce que tu en as fait.
Et alors, ce « ah les crococos ».. Ca sent les mêmes ficelles pour amadouer la descendance, ça..
Haha. Me demande bien qui inventent ce genre de comptines. Et si ils touchent quelque chose en droit d’auteur.
Tout travail mérite salaire………..et ces inventeurs-là m’auront été bien plus utiles, sur des choses essentielles, que 99% de leurs pairs ; bref j’espère bien pour eux que oui.
Sans compter que, danser et mimer sur « ah les crococos, les crococos, les crocodiii-les »……… ==> Faut le faire!
La Coupe Gambardella a la même valeur que la Coupe de France en termes de prestige, pas sûr qu’on trouve un équivalent dans beaucoup d’autres pays.
L’une des preuves de son importance, c’est quand l’OL recrutait des joueurs exprès pour la gagner (notamment Maxwell Cornet). Ca n’a pas marché du tout, quand l’OL gagne en 2022 c’est après la fin de cette politique de recrutement. Mais ce n’est pas anodin.
Lyon, c’est une drôle de relation avec la Gambardella. Ils ont pas forcément gagné les années où ils étaient favoris. On en parlera…
Artelesa, je m’étais jamais penché sur son cas. Dans son époque monégasque, j’avais plus en tête Theo, Douis, Coussou, Carlier…Elle est sympa cette génération. Hidalgo evidemment.
Artelesa, joueur français de l’année..et première fois que j’en entends parler, certainement la décennie post-war que je connais le plus mal chez vous.
Stojaspal en France, je crois bien n’avoir jamais lu ça nulle part avant…………….et dans la foulée, intrigué : je découvre qu’il a entraîné vraiment dans le fin fond ultime de la Belgique??? A Athus?? Lol..
Mexes fut un temps présenté chez nous comme votre next-big-thing, et l’on pouvait en effet pressentir quelque chose, hyper-complet, mais?? Qu’est-ce qui lui a manqué, à ce garçon?
Mexes avait tout en boutique. Physique, technique très correcte pour un defenseur central. Peut-être qu’il lui manquait la volonté.
Stojaspal fait parti de ces mecs pour qui j’ai de la tendresse sans en connaître réellement les contours. Et finalement, c’est pas plus mal…
Mexes avait tout et l’élégance en sus, une belle carrière mais sans doute en deçà de ses capacités. Il est de la génération des Cissé, Vandenbossche, Mathis et surtout Kapo (peut être la plus grande déception de cette génération de l’AJA) .
D’aucuns se souviennent de cette équipe avec les maillots Kappa, floqués PlayStation. Avec Taino, Boumsong & co …… Un bonbon
Belo. J’avoue que j’étais fan de la période auxerroise de Cissé. Cette vitesse et cette force de frappe…
Pourtant une quarantaine de sélections.
Il était surtout arrière-central, pas milieu.
T’as vu Fred ! Petite allusion à Moncla et au Mongol Crauste !
J’ai vu ton allusion et t’en félicite.
Mais arrêtez de parler des années 60 en France, sinon il ne me restera plus de biscuits pour mes articles.
« la terrible ligne offensive Eloi-Malm-Brunel »
CoeurCoeur comme on dit.
Lens 3v, 5d, 8 finales c est nous qu avons le record de finale disputé non ? Club formateur, toujours.
Tu me rappeles aussi qu’Oruma est arrivé très jeune au club. Je ne sais par quel moyen. Pzu utilisé pour la saison du titre. Joueur appréciable.
Niet. C’est Sainté, avec 10 finales pour 4 victoires.
Pour Oruma, je pense que c’est sa prestation au Championnat du Monde cadet 93 qui a tapé dans l’œil des Lensois. Il est meilleur buteur de la compétition et surtout champion. Un peu comme Foé arrivé au club après un Mondial junior.