« For us, the Olympics was everything. There was nothing bigger. »
Sailen Manna, en 2010.
La Coupe du monde au Brésil
C’est lors du congrès de Luxembourg en 1946, que le Brésil obtint l’organisation de la IVe Coupe du monde de la FIFA. Le géant sud-américain avait initialement déposé sa candidature lors du congrès de Paris en 1938, en même temps que l’Allemagne. La compétition n’ayant pas pu avoir lieu, ni en 1942 ni en 1946, leurs candidatures étaient toujours valables au sortir du deuxième conflit mondial. Mais la fédération allemande n’existant plus, c’est à l’unanimité que le congrès confia l’organisation de la compétition au Brésil.
Les Brésiliens demandèrent alors à ce que la Coupe du monde ait lieu en 1949. Cependant, si São Paulo disposait du stade Pacaembu pouvant accueillir entre 60 000 et 70 000 spectateurs, Rio de Janeiro n’avait à cette époque aucune enceinte dépassant les 35 000 places. Capitale du Brésil, la ville se devait d’en être la vitrine. En octobre 1947, après une longue campagne de presse dirigée par Mario Filho, le projet pour l’érection d’un grand stade fut finalement approuvé. Les travaux purent donc commencer dès janvier 1948 mais, en dépit du travail jour et nuit de 1 500 ouvriers, la construction ne pourrait être achevée pour l’été 1949. La commission exécutive de la FIFA décida alors de repousser la tenue de la compétition à l’été 1950. Ce n’est qu’une semaine avant le début du tournoi, en juin 1950, que le gigantesque complexe de plus de 180 000 places fut inauguré. Pas tout à fait fini, le plus grand stade du monde pouvait néanmoins accueillir le premier match de la compétition : Brésil-Mexique (4-0) le 24 juin.

Seize équipes devaient participer à la compétition finale. Un peu plus du double, trente-trois, s’était engagé mais, bien vite, les forfaits furent nombreux : la Belgique, l’Autriche, l’Equateur, le Pérou, l’Argentine, la Birmanie et les Philippines se retirèrent avant même le début des éliminatoires ; le Pays de Galles, l’Irlande du Nord, Israël, le Luxembourg, la Finlande, l’Irlande, le Portugal, la Syrie et Cuba furent éliminés sur le terrain ; l’Ecosse, la Turquie et l’Inde déclarèrent forfaits en dépit de leur qualification ; quant à la France, elle fut d’abord éliminée, avant d’être repêchée et de finalement déclarer forfait !
Ce sont les abandons de dernière minute de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Inde et de la France – d’abord qualifiées, avant de se rétracter – qui furent le plus préjudiciable à l’organisation du tournoi mondial. Ce sont donc ces abandons qui méritent ici d’être expliqués.
La Turquie : des problèmes financiers ?
Présente lors des tournois olympiques de Paris et d’Amsterdam, la Turquie n’avait ensuite participé à aucune Coupe du monde des années 1930. Aux Jeux olympiques de Londres, elle n’avait pas démérité et avait même posé quelques problèmes aux Yougoslaves. L’équipe nationale turque pouvait s’appuyer sur des éléments de valeur qui firent ensuite un bout de carrière en Italie, en particulier l’ailier gauche vedette Lefter.

Debouts, de gauche à droite : Reha Eken, Turgay Şeren, Kamil Ekin, İsmet Berberoğlu, Halit Deringör, Galip Haktanır, l’arbitre italien Gamba.
Accroupis, de gauche à droite : Muzaffer Tokaç, Lefter Küçükandonyadis, Erol Keskin, İsfendiyar Açıksöz, Naci Özkaya.
Au premier tour des éliminatoires, les Turcs se défirent sans difficulté d’une faible équipe de Syrie (7-0). Au tour suivant, ils auraient dû affronter l’Autriche. Mais, soit par peur d’être vaincus ou bien manquant de liquidités, les Autrichiens préférèrent déclarer forfaits. Après un combat minimal, donc, la Turquie validait son billet pour l’Amérique du Sud.
Néanmoins le voyage coûtait cher. Certes, les progrès de l’aviation avaient rendu les conditions de la traversée atlantique autrement plus simples qu’en 1930, mais c’était un voyage bien incertain. Qu’est-ce que les Turcs seraient allés faire à Rio ? Y subir la dure loi des Brésiliens ou des Uruguayens ? N’était-ce pas gâcher de l’argent ? Toujours est-il que ce furent avant tout des considérations financières qui furent mises en avant pour justifier la décision rendue officielle le 20 avril 1950 : la Turquie rendait les armes, elle n’irait pas au Brésil.
L’Ecosse : par fierté ?
En 1946, les quatre fédérations britanniques (anglaise, écossaise, galloise, nord-irlandaise) retournèrent dans le giron de la FIFA qu’elles boudaient depuis les années 1920. En vue de la Coupe du monde au Brésil, elles obtinrent que deux d’entre elles soient qualifiées. L’éliminatoire qui les concernait n’était autre que le British Home Championship (BHC), tournoi annuel qui réunissait les fédérations britanniques depuis 1884. Les deux équipes qui finiraient aux premières places seraient qualifiées pour la Coupe du monde.
Autant dire que l’Angleterre et l’Ecosse avaient déjà leurs billets en poche, tant elles régnaient sur la compétition. Ne restait plus qu’à les composter. Si bien que l’orgueil écossais fut piqué et George Graham, le secrétaire de la Scottish Football Association (SFA), décida de pimenter l’affaire. Contre l’avis de son président, Charles Lamb, il annonça que l’Ecosse n’irait au Brésil que si elle finissait à la première place !
La compétition démarra comme convenu : à l’automne 1949, les Ecossais et les Anglais marchèrent sur les Gallois et les Irlandais (8-2, 4-1, 2-0, 9-2). Le match décisif entre l’Ecosse et l’Angleterre se tint le 15 avril 1950 à Glasgow. Pour l’occasion, Hampden Park était plein à ras bord (138 000 spectateurs). Et, bien sûr, ce furent les Anglais qui l’emportèrent (1-0).

Malgré les suppliques des joueurs écossais, George Graham ne se dégonfla pas et proposa devant l’assemblée générale de la SFA que l’équipe d’Ecosse déclara forfait pour la Coupe du monde. La question fut portée aux voix le 26 avril et, le lendemain, la nouvelle s’affichait dans la presse sportive du monde entier : « Le onze national d’Ecosse n’ira pas à Rio » (L’Equipe).
S’il est possible que la décision écossaise cacha d’autres motifs – les suppositions allèrent bon train –, il n’en demeure pas moins que rien d’autre ne filtra : l’Ecosse se priva volontairement de sa première participation à une Coupe du monde par fierté. Une bouderie qui en dit long sur la valeur que les Ecossais accordaient alors à la Coupe du monde de la FIFA : les fédérations britanniques considéraient en effet le BHC comme le véritable championnat du monde.
L’Inde : un problème de chaussures ?
Il est un mythe puissant qui, heureusement, tend désormais à s’étioler : l’Inde aurait été privée de la Coupe du monde au Brésil parce que la FIFA interdit à ses joueurs de pratiquer pieds nus, trahissant ainsi l’insupportable mépris de la toute-puissante organisation mondiale vis-à-vis des sans-grades du football. Récit édifiant, anecdote brillante, à ceci près qu’elle est fausse.
Nouvellement indépendante, l’Inde connaissait alors son âge d’or footballistique. Porté par des joueurs comme le défenseur Sailen Manna, le charismatique demi-centre Talimeren Ao ou l’intérieur gauche Ahmed Khan – comparé par la presse française à Ben Barek –, les Indiens participèrent d’abord au tournoi de football des Jeux de Londres. Ils y créèrent la surprise puisqu’ils tinrent tête aux Français. Manquant deux penalties, ils ne plièrent finalement qu’à la 89e minute (1-2).

Jouant « sans aucune organisation », mais « extrêmement vifs, adroits, bons feinteurs », les Indiens étaient pour la plupart dépourvus de chaussures. Huit sur onze, pour être exact. Cette pratique du football pieds nus n’était pas la conséquence de la misère de l’Inde, elle était un choix. A l’époque du Raj, lorsque les Indiens s’approprièrent le jeu du colonisateur, ils le subvertirent pour se distinguer des maîtres : face aux Britanniques bottés, les Indiens jouaient pieds nus. Ainsi en 1948, autant par bravade que par tradition, les footballeurs indiens pratiquèrent-ils sans chaussures. Ce qui fit dire au capitaine Ao, devant une presse largement acquise à sa cause, qu’ils jouaient au « football » quand les Européens jouaient au « bootball ».
Qualifiée sans jouer, du fait des forfaits en Asie, l’Inde devait prendre la route de Rio. Elle s’y était préparée et avait été placée dans le groupe de l’Italie, de la Suède et du Paraguay. Brusquement, toutefois, l’Inde annonça officiellement son forfait le 23 mai 1950. Un télégramme laconique, auquel devait succéder une lettre d’explication. L’absence de cette dernière, soit qu’elle n’exista jamais soit qu’elle soit aujourd’hui introuvable, alimenta les discours les plus divers : l’Inde aurait été privée de compétition par la FIFA, l’Inde aurait été trop pauvre pour payer le voyage… Rien de tout cela n’est véritablement satisfaisant.
D’une part, c’est la FIFA qui organisait le tournoi de football des Jeux olympiques, tout comme elle organisait la Coupe du monde. Si elle autorisa les Indiens à joueur pieds à Londres en 1948, puis à Helsinki en 1952, il est peu probable qu’elle ne les autorisa pas à jouer pieds nus au Brésil en 1950. Et quand bien même, pour la gloire d’une Coupe du monde, il eut été bien possible de trouver une dizaine de paires de chaussures et que les Indiens se forcent à les utiliser !
D’autre part, l’Inde envoya une délégation à Londres et à Helsinki : elle avait donc bien les moyens d’en envoyer une au Brésil. C’est un fait que la All India Football Federation (AIFF) ergota et avança des difficultés financières, mais les fédérations du Bengale, de Mysore et du Maharashtra se mobilisèrent. Mieux : la fédération brésilienne offrit de payer le voyage de Calcutta à Rio.
Quel fut alors le problème ? Difficultés d’organisation, désaccord sur le choix des joueurs, peur d’être ridicules ? Il y a surtout que, pour les Indiens en 1950, la Coupe du monde représentait peu de choses. La vraie compétition mondiale était pour eux les Jeux olympiques. Ils snobèrent donc un tournoi pour lequel, en outre, ils s’étaient qualifiés sans grand mérite, presque par hasard.



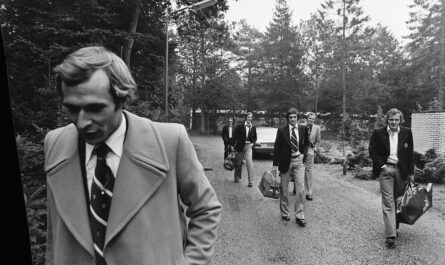

Avant que le Maracanã ne soit édifié, le grand stade de Rio est celui de Vasco, le São Januário et son élégante façade de style néo-colonial. Sa capacité a varié et n’a jamais été très précise mais on estime que dans sa version initiale, il pouvait accueillir entre 40 et 50 mille personnes.
Au milieu des années 1920, le Brésil est en proie à de fréquents troubles sociaux et le président de la Vieille République Washington Luís (cf. article de mercredi sur Zezé Moreira) est très impopulaire. Ses opposants lui reprochent de favoriser le développement économique de l’état de São Paulo, là où il a construit sa carrière d’homme politique. Et parmi les griefs des cariocas, il entraverait la construction de l’Estádio São Januário, le plus grand d’Amérique du Sud à l’époque, un ouvrage privé autofinancé par le club de Vasco da Gama, en interdisant l’importation de ciment belge et en renchérissant l’édification du monument. Cela n’empêche pas Washington Luís de parader lors de l’inauguration en avril 1927 lors d’un match entre Vasco et Santos. C’est là que le Brésil accueille le plus souvent ses adversaires internationaux (auparavant, c’étant à Laranjeiras, le stade de Fluminense).
Pour le stade du Vasco, édifié en 1927, j’avais trouvé comme capacité en 1947 : 35 000. C’est alors le plus grand stade de Rio.
Esthétiquement, difficile de trouver plus beau que le Maracanã à mon goût. Ovale parfait, tribunes en pente douce, c’est quand même bien plus agréable à regarder que les stades au carré et leurs tribunes verticales.
Le Maracanã porte désormais le nom de Mário Filho tant il fut important dans la décision de construire ce stade. Bon, vous le savez sans doute mais Filho est incontournable dans le foot brésilien : outre son lobbying pour le Maracanã, il a écrit un bouquin sur l’apport des Noirs au football brésilien à l’époque où la dictature de Vargas est à l’œuvre, il a magnifié les Fla-Flu en les appelant les clássicos das multidões (les classiques des foules), il participé à réhabiliter Barbosa et les défenseurs de couleur mis en cause lors du Maracanaço etc…
Merci Bobby. On attend la suite avec impatience et une réponse à la question que tout le monde se pose : pourquoi la France fut elle absente de cette CM ?
Je te le donne en mille : c’est croquignolesque.
Du pur esprit gaulois !
Des coqs vantards et bruyants, bien vite émasculés : nous autres, Français, dans toute notre splendeur…
En dehors de l’immense Küçükandonyadis, sur la photo de la Turquie, on peut parler de Turgay Şeren le gardien. Indéboulonnable de 1950 à 66, il fut surnommé la panthère de Berlin pour une grande partition face à l’Allemagne en 51. Gloire de Galatasaray.
Connaissant ton appétence pour le football turc et tes grandes connaissances sur celui-ci, je savais que cette photo que plairait.
Connaissances, on va pas exagérer non plus ! Şeren, tu tombes rapidement dessus en se penchant sur le foot turc. Pour les autres gardiens, hormis Rustu, on peut également parler d’Özcan Arkoç qui fit toute une carrière à Hambourg, époque Seeler. Il est d’ailleurs finaliste de la c1 68. Ou de Şenol Güneş qui était le dernier rempart du Trabzonspor triomphant des années 70-début 80. 6 titres de champion pour la meilleure période de ce club. Ce sont les 4 noms qui me viennent spontanément m.
Ahah, cher Bobby, la bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe.
Par rapport au forfait autrichien ?
Comme raisons invoquées, j’ai trouvé soit des difficultés financières, soit la peur d’être vaincus car équipe formée de joueurs jeunes et inexpérimentés.
Tu as une autre version ?
Mieux qu’une autre version, môsieur, j’ai la Vérité. Raisons financières.
Dans l’équipe de 50, il y a des Ocwirk, Zeman, Happel, Hanappi, Dienst, Decker, Melchior ou Aurednik.
En 62, ce sont aussi des raisons financières, qui empêchent la participation. Coûts du voyage, mais aussi des problèmes avec les clubs viennois, qui avaient davantage de frics à se faire avec les tournées. Cela avait d’ailleurs pourri la CdM 58.
Tu veux dire que le voyage au Brésil coûtait trop cher ?
Ou plutôt que les clubs préférèrent se faire de la grosse monnaie avec leurs vedettes dans de lucratives tournées, plutôt que de les céder à l’équipe nationale pour défendre la fière bannière de l’Autriche ?
En 50, problèmes financiers de la fédé, à ce qu’il semble. Possible qu’il y ait aussi eu du rifif avec les clubs à l’époque, mais ça c’est plutôt pour 62.
Tout pareil en Belgique : d’autres chats financiers à fouetter, + argent à grapiller au gré de l’une ou l’autre tournées. L’on organisa donc un amical face aux Suisses qui n’en demandaient pas tant, que sanctionna une victoire nette (et diplomatique??) pour pallier ce forfait et faire avaler la pilule. Dommage car l’EN BE était assurément l’équipe du Nord-Ouest européen la moins mal en point, ceci dit : pas de quoi prétendre sérieusement à quoi que ce soit face à des formations sud-américaines.
Ecossais et Indiens qui snobent la WC, au motif voire prétexte qu’ils n’y prêtaient pas un grand poids, pourquoi pas..mais quand et comment la WC s’impose-t-elle alors à tous (!) comme l’incontestable must en matière de football?
Les Ecossais dédaignant la WC, alors que ça faisait 20 ans qu’ils se prenaient de régulières (et parfois castardes) dérouillées sitôt franchie la Mer du Nord…… ==> Il y a certes des mensonges auxquels l’on finit par croire à force de les marteler, mais les Ecossais croyaient-ils vraiment en la supériorité des footballs britanniques??
Ah ah, cher Alexandre, toujours un coup d’avance…
La conclusion de ma deuxième partie, lundi, répondra à la question posée dans ton deuxième paragraphe.
Concernant le sentiment de suprématie des Britanniques, en dépit de déconvenues assez sévères sur leur propre sol, les Anglais continuent d’y croire dur comme fer pendant toutes les années 40. Le BHC me semble conserver, dans le chef des Britanniques, toute son importance et son prestige.
Enfin, il est évident que Belges, Turcs ou Indiens avaient largement les moyens de financer le déplacement au Brésil. Mais ils préférèrent s’abstenir, car ils n’avaient pas encore pleinement conscience de l’importance de la compétition mondiale de la FIFA. C’est le même problème qu’en 1930. Les questions financières ne furent qu’un prétexte : ils mirent plutôt l’argent ailleurs, dans d’autres matchs, dans d’autres tournois. L’histoire leur donna tort. Ma conclusion sera sans appel.
..seconde partie que je n’ai pas lue! (m’en suis gardé exprès)
Je devine toutefois peut-être ce qu’il en fut des Français, et pour cause : lu jadis pas mal d’archives NL qui en traitaient, on verra si tu aboutis aux mêmes conclusions.
Belgique 1950, détail rigolo : les Belges n’y sont donc pas……….et cependant c’est au cours de ce tournoi que, pour la première fois, un joueur belge parvint à remporter un match en WC.
Pour l’Oncle Sam, mon cher Alex… Hehe
D’ailleurs Bert Patenaude qui, on l’oublie souvent, a atteint les demi-finales du premier Mondial de l’histoire avec les States, avait des origines francophones mais lesquelles ?
Pour le forfait belge en 50, je n’ai jamais rien vu/lu d’autre que le récit d’un pays qui peinait encore à se remettre de l’occupation, et avait d’autres chats à fouetter, mais?? C’est toujours stimulant d’interroger un récit, pourquoi pas. Ils étaient quand même là en 1930 (des premiers, même), 34, 38..mais soudain désistés pour 50, par..désintérêt?? Ca ne me dit décidément rien.
En 54 : un joueur tel que Lemberechts (toujours en feu en 50, et qui restait l’une de nos têtes de gondole en 54), que j’évoquais dernièrement, se désiste pour des questions d’argent, privilégier une tournée plus profitable ailleurs avec son club.. ==> Intuitivement, je suis davantage tenté par cette lecture vénale des choses (qui d’ailleurs resterait patente une pleine génération plus tard au sein de pas mal de sélections parfois prestigieuses) que par la question symbolique (qui ne manque certainement pas d’intérêt! – le cas indien en atteste) de la légitimité/portée/reconnaissance du tournoi FIFA.
Probablement issu de la Seine-Maritime et/ou de l’Oise, dixit Geneanet.
M’avait marqué ce nom, quand je découvrais gamin l’Histoire des Coupes du Monde.. Lui et 2-3 autres : Stabile, Laurent.. Des buteurs ; c’était compliqué d’en retenir autre chose.
Patenaude, Andrade, Pedro Cea, Langenous, ce sont mes premiers souvenirs de lecture de l’histoire du Mondial, oui.
Mais en 1930, ce n’est pas la fédération belge qui prend la décision d’envoyer une équipe en Uruguay : ce sont les Affaires Étrangères. Idem en France, c’est une décision politique et non sportive. Sans l’intervention des ministères, ni la France ni la Belgique ne participent en 1930. C’est factuel.
D’où mon intuition qu’il s’agit, pour les Européens, d’une tournée diplomatique. La France visite un pays ami, flanqué de trois de ses alliés : Belgique, Roumanie, Yougoslavie.
Puis, en 34 et 38, les compétitions ont lieu en Europe.
Donc oui, en 50, que les mêmes réticences se soient manifestées qu’en 30, ça me paraît plausible.
Et oui, en 1950, pour les instances sportives et les footballeurs hors d’Amérique du Sud, il y avait des trucs plus importants que la Coupe du monde de la FIFA. Impensable 20 ans plus tard, a fortiori aujourd’hui. Ce virage s’établit dans les années 60 et, rétrospectivement, les absents de 50 en furent fort marris. Surtout les Indiens qui n’eurent plus jamais d’autres occasions de participer : d’où la création de l’anecdote sur les chaussures, pour ne pas paraître ridicules…
Je réserverai ma réaction à la lecture de la deuxième partie, c’est le mieux à faire.
Mais pour les Belges : décidément jamais rien lu d’autre qu’une question d’argent et de priorités. C’était la cata, la situation de la Belgique à l’époque ; des crises existentielles à n’en plus finir après que l’Allemagne se fut employée à diviser tant et plus Flamands et Wallons. Le foot était vraiment le dernier des derniers soucis de ce pays convalescent. Il y eut peut-être autre chose, mais??
Les Pays-Bas, ça rejoint au mot près ce que tu rapportais pour l’Autriche : équipe amateur jugée trop faible et inexpérimentée, c’est explicitement et officiellement pour cela, dès l’automne voire l’été 1949 au moins, qu’ils déclarèrent forfait. Eviter le ridicule……… C’est du moins ce que leur fédération affirma! 😉 Car la situation financière et politique était tout sauf brillante à l’époque aux Pays-Bas. Parmi les pires combats ayant concouru à l’indépendance de l’Indonésie (une lutte impitoyable, qui préfigura l’affaire algérienne) furent concomitants de cet abandon footballistique. Et pas mal de footballeurs étaient d’ailleurs mobilisés pour mener cette sale guerre contre-insurectionnelle, remember le destin du père de Hoeki Hoekema, Jan : https://www.pinte2foot.com/article/divergents-1-5-oeki-de-texel
J’avais zappé la non-participation aux qualifications 1962 de l’Autriche…
Alex, l’argument financier me semble aussi bidon en 50 qu’en 30. C’est une fausse excuse. Et, comme tu l’écris, il y avait d’autres priorités, y compris sportives. D’autres priorités qu’une Coupe du monde. Chose impensable aujourd’hui : même pour y être ridicules, même pour un pays en guerre civile, même pour un pays envahi par une puissance étrangère, la Coupe du monde est un Graal suprême et nul ne s’en priverait volontairement. Là, ils furent si nombreux à le faire…
Roy Bentley de Chelsea, ça parti de cette kyrielle d’attaquants anglais aux stats impressionnantes mais que je ne saurais réellement évaluer.
J’ignorais que l’Inde avait eu une équipe intéressante fût un temps ! Super article, merci Bobby !
Les années 40-50 correspondant à l’âge d’or du football indien :
– participation aux Jeux de Londres, Helsinki, Melbourne (demi-finale), Rome ;
– organisation des premiers Jeux asiatiques en 1951, et victoire dans le tournoi de football ;
– des footballeurs talentueux comme Ao, Khan, D’Souza.
Le football était particulièrement implanté dans le Bengale, avait percolé depuis les pratiques du colonisateur.
Un article édifiant en première page de L’Equipe du 4 janvier 1950 (plus d’infos à l’intérieur) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t5100571h