
« A présent, nous sommes sans doute éveillés ».
Arthur Schnitzler, La nouvelle rêvée, 1926.
La presse européenne se passionnait pour la Coupe du monde. C’était, des deux côtés de l’Atlantique, le grand événement footballistique du moment. La politique, déjà impliquée du côté américain, ne tarda alors pas à s’immiscer dans l’affaire côté européen. Le ministre des Affaires étrangères italien Dino Grandi prit effectivement la parole la veille de la demi-finale et déclara que « les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol ». Simple boutade ou revendication territoriale ? Alors que le fascisme ne cessait de proclamer son intention de récupérer les terres irrédentes, les Argentins optèrent pour la deuxième solution et s’offusquèrent : ce fut un tollé. Quelle que fut l’intention de Grandi, une chose était sûre : il avait réussi à pourrir l’ambiance d’une rencontre qui avait déjà été électrique lors du premier tour.
Dès l’entame du match, les Argentins ciblèrent donc Julio Libonatti, proclamé traître à la nation. Lui, l’oriundo qui avait d’abord joué pour l’Argentine avant de traverser l’Atlantique, fut finalement mis hors d’état de jouer par un autre oriundo : Luis Monti. Vengeant toute une nation, et proclamant par là-même son appartenance à celle-ci, le demi argentin adressa un incroyable high kick à l’avant italien. Blessé à la poitrine, Libonatti dut quitter le terrain tandis que l’arbitre Langenus signifiait une exclusion à Monti. Quatre-vingts ans plus tard, quelques puristes se souvinrent de ce geste et le comparèrent à celui de Nigel de Jong sur Xabi Alonso. Sans doute n’avaient-ils pas tout à fait tort…
A 10 contre 10 (les remplacements étant alors interdits), le match reprit et offrit un spectacle de très haut niveau. La virtuosité des Argentins parla en première mi-temps : Stabile marqua deux fois. Au retour des vestiaires, ce fut au tour des Italiens de montrer leur fougue : Meazza fit de son mieux et permit à Baloncieri de réduire l’écart. Le public, passionné par ce duel intense, scrutait avec admiration chaque action. Des ondées vinrent arroser les vingt acteurs et obligèrent les spectateurs à déployer force parapluies. Ils furent sans doute quelques-uns à ne pas voir l’égalisation italienne !
A 2-2, la donne changeait : les Argentins remirent le pied sur le ballon et quadrillèrent le terrain. La solution vint alors du petit ailier Evaristo qui marqua d’abord, avant d’adresser une passe précise à Guillermo Stabile. Ce dernier y alla de son troisième but, au grand dam de Combi qui ne put rien faire. 4-2, le match était plié, l’Argentine jouerait la finale de la Coupe du monde. Mais contre qui ? Les favoris uruguayens ou bien les outsiders espagnols, que personne n’avait imaginé à pareille fête ?
Ce furent évidemment les Uruguayens, qui maîtrisèrent leur match avec brio. Zamora, impuissant, alla chercher le ballon sept fois au fond de ses filets. 7 buts à 1, score final, il n’y avait eu aucune ambiguïté : la supériorité uruguayenne était flagrante. Les spéculations allèrent néanmoins bon train pour tenter d’expliquer la si incroyable faillite de celui qui était alors, sans doute, le meilleur gardien du monde.
Les uns invoquèrent évidemment la qualité des avants uruguayens, quand les autres s’en prirent à la mollesse de défenseurs espagnols rincés par l’homérique quart de finale disputé à peine quelques jours plus tôt. D’aucuns, toutefois, invoquèrent des explications plus troubles et souterraines, évoquant corruption, magouille politique ou à-plat-ventrisme sportif. Les plus perspicaces soulevèrent le fait que c’était pendant cet été que Zamora avait été transféré au Real Madrid en échange d’une somme alors inédite.
Indéniablement, un tel transfert aurait pu accaparer l’esprit du portier espagnol et expliquer sa mauvaise performance, mais comment prouver que les négociations avaient déjà commencé ? Ce n’est qu’en 1996 que le conservateur adjoint de la bibliothèque de Montauban, Jean-Pierre Vérane, put établir les faits de manière indéniable. Transitant par Barcelone et Toulouse, un courrier signé par le président du club madrilène était parvenu à Montevideo – via l’Aéropostale – le 31 juillet à destination de Ricardo Zamora : les propositions étaient mirobolantes ! Pour une raison inconnue, une copie de ce courrier avait été conservée dans les archives de l’Aéropostale puis dans celle d’Air France et, pendant l’Occupation, avait échu dans les collections des Archives départementales du Tarn-et-Garonne !
Quoiqu’il en soit de ces considérations, il restait maintenant aux Uruguayens à triompher de leurs cousins argentins pour atteindre le Graal du football mondial. Mais avant cela, Italiens et Espagnols devaient se départager.
Le 4 août à 15 heures, dans le stade de Gran Parque Central, l’Italie s’adjugea la troisième place devant une foule clairsemée (2-0). Même John Langenus préféra aller se promener à Buenos Aires plutôt que d’assister au match qui devait décider de la meilleure équipe européenne. C’est dans la capitale argentine qu’il reçut le télégramme lui annonçant qu’il avait été désigné pour arbitrer la finale. Le soir, il traversa donc le rio de la Plata au milieu d’une foule en délire qui hurlait : « Argentina, si ! Uruguay, no ! » Des pétards, lancés par des gamins, faisaient un boucan du diable. Finalement, le 5 août à 15 heures, Langenus était au sifflet et il lança la rencontre devant une foule nombreuse, fervente et particulièrement correcte – en dépit du contexte…

La veille, la presse argentine avait demandé son sentiment à Carlos Gardel. Lui, le roi du tango, l’ami des Argentins dont les racines étaient pourtant en Uruguay, de quel côté son cœur penchait-il ? Diplomate, l’artiste répondit qu’il ne pouvait choisir et souhaitait tout simplement que le meilleur gagnât. Et, pour ne pas trahir ses émotions, il se priva de la finale de la Coupe du monde. Si bien que dans les tribunes – là où Blaise Cendrars aurait aimé faire connaissance avec le plus beau représentant de l’Amérique du Sud –, Frédéric Sauser resta seul, attentif tout de même à l’incroyable spectacle qui se déroulait sous ses yeux.
A la mi-temps, la stupéfaction régna dans le Stade du Centenaire : l’Argentine menait par deux buts à un. Après avoir été surpris sur un but rapide de l’ailier Dorado, les Argentins dominèrent nettement les débats : Carlos Peucelle égalisa rapidement, avant que le meilleur buteur de la compétition Guillermo Stabile ne permit à son équipe de prendre l’avantage. Heureusement pour les Uruguayens, les arrières Nasazzi et Mascheroni furent vigilants et annihilèrent plusieurs offensives adverses.
A la reprise, les Uruguayens se ruèrent à l’attaque dans l’espoir d’égaliser. Ils y parvinrent par l’intermédiaire de Pedro Cea, peu avant l’heure de jeu, mais la menace argentine était constante. Il fallut tout le sang-froid de la vedette locale Scarone pour faire se lever le stade : il décala l’ailier Iriarte, qui trompa Botasso d’une frappe puissante. L’enthousiasme était à son comble. La fin du match approchait, chacun retenait son souffle. Stabile frappa alors la barre transversale, les Uruguayens contre-attaquèrent et plièrent le match sur un ultime but du manchot Castro. 4-2, score final.
Un petit pays de deux millions d’habitants régnait donc pour la troisième fois sur le football mondial. Cette triple couronne consacrait une politique sportive de haut vol et un football porté au paroxysme de l’art. Les plus hautes autorités politiques du pays, présentes pour le match, pouvaient être satisfaites. Les joueurs entamèrent un tour d’honneur, tandis que le président de la FIFA remettait au président de l’AUF la victoire ailée sculptée par Abel Lafleur. On se donna rendez-vous dans quatre ans. En Europe.
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
















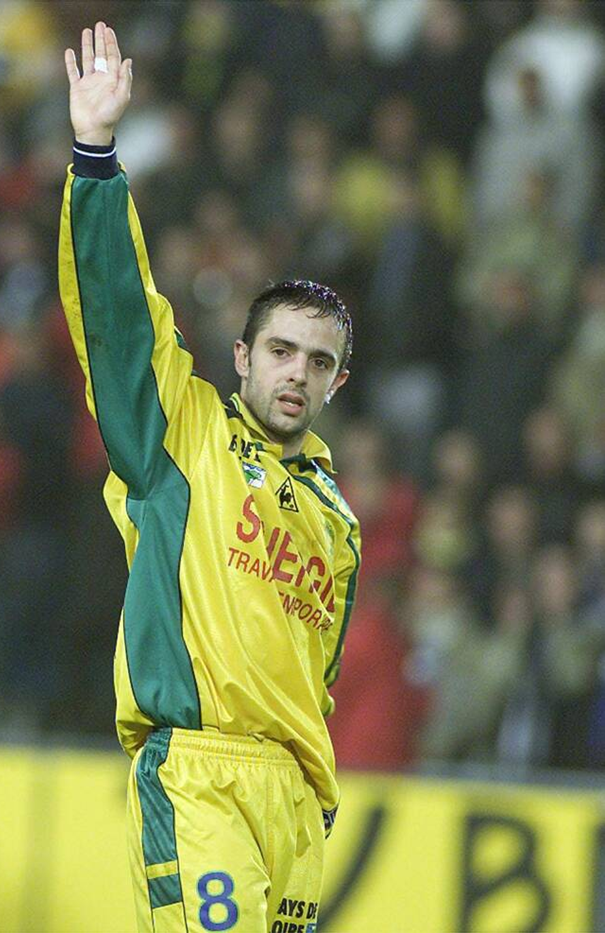













« les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol. » C’est vrai mais j’ai toujours trouvé que ça passait sous silence le lien avec l’Espagne.
Tu contestes les propos de Borges ? Tu vas avoir des ennuis, ici eh eh
Haha. Je ne nie pas l’influence italienne mais entre les Espagnols venus à l’époque de la colonie et ceux arrivés après l’indépendance, les Argentins d’origine sont largement majoritaires.
Argentins d’origine espagnole…
« Étant donné que la plupart des immigrants arrivés en Argentine avant le XXe siècle étaient espagnols, et que près de la moitié des immigrants arrivés en Argentine au cours de ce siècle étaient d’origine espagnole, la majorité des Argentins sont d’ascendance espagnole, totale ou partielle. De plus, depuis la déclaration d’indépendance de l’Argentine jusqu’à nos jours, des personnes d’origine espagnole originaires de toute l’Amérique latine ont émigré en Argentine en quête d’opportunités économiques et se sont facilement intégrées au pays grâce à ces origines communes. Du fait de cette ascendance espagnole prédominante, l’Argentine et l’Espagne partagent encore de nombreux aspects et éléments culturels (la langue espagnole , la religion catholique et diverses traditions culturelles). Les Argentins et d’autres immigrants méditerranéens, comme les Italiens (deuxième contributeur culturel à l’ Amérique latine après les Espagnols), ont contribué à forger une culture argentine aux caractéristiques propres. Cependant, l’héritage de la culture espagnole demeure en Argentine, comme dans le reste de la région. Les Espagnols constituent la plus importante contribution ethnique et historique au pays, suivis par les peuples autochtones du territoire argentin et les immigrants italiens. »
ce narratif est surtout l’oeuvre d’une élite depuis buenos aires, c’est pour ancrer l’identité argentine dans la sphère européenne, pareil avec la phrase « descendants des bateaux », comme si il y avait rien avant, c’était pour nier et masquer le métissage, les traits et cultures indigènes, qui étaient majoritaires dans l’interior. même si la migration italienne était importante, elle
D’ailleurs, quel est le pourcentage de la population autochtone avant les grandes vagues d’immigration en Argentine ? Ce sont vraiment des peuples que l’on a cherché à rendre invisibles.
De loin l’auteur que j’ai le plus lu…………et pas moi qui détromperai quiconque sur le nombre de conneries-coquetteries qu’il aura pu balancer.
Paradoxalement, l’Argentine ne dispose pas, légalement, de langue officielle. Même si l’espagnol (surtout son dialecte rioplatense) l’est, de facto. L’italien est parlé par environ 1,5 millions d’Argentins. Les langues autochtones les plus parlées sont le quéchua et le guarani.
Libonatti, dans le top 10 du Toro ?
Top 10-12…
Comme ça, sans trop réfléchir, devant lui : Mazzola et Maroso du grande Torino, Pulici, Sala, Zaccarelli et Graziani du titre 1976, Ferrini juste avant et dans les années 20, Baloncieri. En revanche, Meroni, c’est plus un martyr, il a moins marqué l’histoire sportive du Toro que les autres, je ne le mets pas top 10.
Ah oui, Meroni pas dans le top 10 ? C’est quand même l’enfant cheri…
Et ce Scifo si cher au coeur de Khiadiatouline (j’écris cela sans ironie, y a plein de bonnes raisons d’apprécier et l’homme et le joueur)? Il avait été très bon au Torino, taille patron.. ==> En dépit des précédents illustres, un joueur important dans leur Histoire, non?
Le George Best italien dit-on, un homme ancré dans son époque quand l’Italie demeure traditionaliste… Un joueur suspendu pour dopage au Genoa (avec d’autres, certes), quelques sélections avec la Nazionale pas vraiment probante (rien ne dit qu’il aurait joué la phase finale de l’Euro 1968). Un talent parmi d’autres mais une posture singulière et un destin tragique qui en font une icône du Torino.
C’est ça le problème avec Verano. Il n’est romantique. Ce qui importe pour lui, c’est le gain. Hehe
Vous avez eu un fanion du Toro dans votre chambre ? Non donc c’est moi qui fait autorité en la matière. Le Torino, c’est moi !
Oui oui, Scifo fait un passage intéressant époque Mondonico mais il ne peut pas rivaliser avec ceux que j’ai cités me semble-t-il. Et encore, y en a plein d’autres que je positionnerais devant lui : Loik, Gabetto, Bacigalupo des années 40, Bearzot dans les 60es, Caporale et Pecci en 1976 et j’en oublie certainement. Top 25-30 peut être pour Scifo ?
J’oublie Gino Rossetti, le 3ème larron du Toro de la fin des années 20 avec Baloncieri et Libonatti.
Doit pas y avoir cinq Français, non plus, qui ont eu dans leur chambre un fanion de l’Antwerp.
@Verano : Bearzot joueur…………. J’allais te demander s’il était si bon que ça, le genre de joueur………et puis, tilt : n’as-tu pas fait un article sur lui?? Je confonds sans doute.
Je relis en diagonale : pas le moindre étranger parmi tes joueurs les plus marquants du Toto? C’est vraiment la question du candide.
Bearzot sélectionneur en 1978, oui.
En tant que joueur, je ne l’ai évoqué que dans la série sur Catane.
Au Toro, il est un symbole je trouve. Dans les 50es, il incarne le déclassement du club après Superga, et ce jusqu’à la relégation. Mais il reste au club et fait partie de ceux qui relancent un cycle avec le nouveau président Orfeo Pianelli. Bearzot est là aux côtés des jeunes Ferrini, Agroppi, Vieri (Lido).
Tu parlais des étrangers du Toro… Gerry Hitchens, Nestor Combin ?
Oh, je ne visais ni n’attendais un étranger en particulier, club que je connais mal, c’est juste que c’est peut-être pas si commun, un club italien dont les belles périodes sont quand même chroniques et pour lequel, pour autant, aucun renfort étranger ne vient spontanément (et fort possiblement raisonnablement – je ne peux décidément en juger) à l’esprit.
Je vais aller relire Catane, j’avais bien aimé cette série-là et ça m’avait parlé que tu y évoques le passé de Bearzot, merci d’avoir resitué l’article.
@Alex
Au Torino ? Y a eu Júnior, et ça s est tres bien passé pour lui. Surtout la 1ere saison. On reparlera de lui forcément dans le top à venir cette semaine.
Alex. Oui, c’est certain. Hehe
Les scénarios auraient pu être différents, mais peu importe lequel, la conclusion aurait été la même à chaque fois : une finale Uruguay-Argentine. Car les deux nations rioplatenses étaient au dessus de toutes et pas qu’un peu, il y avait un écart majeur que les autres football, qu’ils furent participants ou absents, ne pouvaient pas combler.
C’est mon propos.
Oui oui j’ai bien compris, je le souligne pour bénir tes propos haha
Merci Bobby. On attend les éditions 42 et 46 désormais !
Et 1934 et 193 ? Car là, le scénario aurait été différent et la conclusion également. L’absence des deux nations (l’Argentine a envoyé une équipe Z d’amateurs en 1934 je rappelle) a laissé le champ libre aux autres…
*1934 et 1938
Les Français ont-ils noué des liens avec les Belges et les Roumains sur le Conte Verde ?
Français et Belges, oui. De mémoire, c’est sur l’article « Le Père » que j’ai adjoint une photo où s’entremêlent les joueurs des deux sélections.
Les Roumains : aucune idée.
Ah non, j’ai été voir : c’est une photo du retour que j’avais mise. Où je n’avais pas souvenir que figurât d’ailleurs un..Roumain.
https://www.pinte2foot.com/article/lectures-2-foot-episode-13-le-pere
Quelles conclusions tirer de sa présence : aucune idée, je n’ai souvenir de rien à ce propos.
Pour le trajet-aller, l’existence d’échanges permanents entre délégations française et belge est explicite dans les mémoires de l’entraîneur belge Goetinck.
Pourquoi pas refaire la coupe du monde 1934,avec la participation de l’équipe d angleterre,ecosse,argentine la vraie equipe,l uruguay,et en partant du principe que MONTI,ORSI,joueurs argentins jouent avec l argentine.
Voici mes equipes ANGLETERE/1HIBBS 2TOM 3EDDIE HAPGOOD4CLIFF BRITTON5ERNS HART6COPPING7CROOKS8RAICH CARTER9DIXIE DEAN10CLIFF BASTIN11ERIC BROOK.
ARGENTINE/1BELLO2TARRIO3CUELLO4MINELLA5MONTI6SUAREZ7PEUCELLE8VARALLO9BERNABE F
ERREYRA10ANTONIO SASTRE11ORSI.URUGUAY/1BALLESTEROS2NASAZZI3MASCHERONI4ZUNINO5FERNANDEZ6GESTIDO7DORADO8CIOCCA9CASTRO10ENRIQUE FERNANDEZ11BRAULIO CASTRO.Je pense qu avec ses equipes l argentine et l angleterre auraient ete favorites,ainsi que l autriche avec en plus HIDEN/NAUSCH/BINDER/GSCHWEIDL
Et on la jouerait en Angleterre. Chiche ?
Je l’avais déjà dit quelque part, mais il y aucune raison qui montre que l’Uruguay aurait été moins forte. Une participation en 34 au complet: elle est favorite numéro un à sa succession.
L’Argentine joue une série de matches en 1933 et 1934 avec son équipe de la ligue professionnelle qui regroupe les meilleurs clubs (pas celle qui ira donc à la coupe du monde 34 qui était formé parmi les joueurs du championnat officiel resté amateur et reconnu encore par la FIFA comme tel), bilan sur les 5 confrontations contre la Celeste : 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc elle aura été aussi au RDV.
Dans le onze que tu donnes, je serais partisan de considérer Monti et Orsi comme ils ont fait: jouer pour l’Italie hehe.
Dans les buts, Bossio (qui avait rejoint River Plate au passage du professionnalisme) était plutôt le choix 1 à cette époque. Bello (Independiente) un choix cohérent aussi en n2.
En défense, la paire Tarrio (Newells) – Cuello (River Plate) en défense, c’est carrément ce qui se faisait de mieux à cette époque. Mes remplaçant seraient Fazio (Independiente, qui était réputé pour sa défense ) et Scarcella (Racing) le successeur de Paternoster à l’Academia.
Au milieu: Minella (Gimnasia LP) rayonne et cerveau du milieu de terrain, on peut mettre Arico Suarez (Boca Juniors) déjà là en 1930 sur le côté gauche, et à droite ma préférence irait à Carlos Santamaria (River Plate) qui est un des joueurs les plus influents dans le jeu argentin des années 1930 et qui ira plus tard faire école au Brésil à Fluminense et s’est construit une belle réputation à Rio. Remplaçants: Lazzatti, le nouveau crack de Boca qui est champion en 34, Antonio De Mare (Racing) et Rodolfo De Jonge (Independiente), ces deux derniers sont des réguliers de la sélection dans le milieu des années 30 et pouvaient dépanner sur la ligne médiane à peu près partout.
Devant: Miguel Lauri (Estudiantes LP) est le meilleur ailier droit du moment et il brille avec Los Profesores d’Estudiantes, et Arturo Arrieta (San Lorenzo) de même à gauche est celui qui est le plus mis en valeur. Pour doubler les ailes, respectivement à droite et gauche, l’expérimenté et tacticien du terrain Peucelle (River) et l’étoile filante Tomas Beristain (Platense), sorte de crack, dribbleur fou d’après les écrits de la presse qui éclos à ce moment là mais ce fut éphémère.
Sastre (Independiente) déjà multifonctionnel et excellent, est évidemment mis en inter droit et la star de Boca, Cherro (remis de ses « traumas ») en inter gauche. Varallo (Boca Juniors) et Diego Garcia (San Lorenzo) qui a eu le droit à son portrait dans le top de San Lorenzo que j’ai écrit sur ce site, comme options secondaires.
Avant-Centre: pas l’ombre d’un doute: B. Ferreyra (River Plate) . Les avant-centres buteurs et puissant sont à la mode au milieu des années 30. Mon choix 2 se porterait sur le buteru d’El Expreso Arturo Naon (Gimnasia LP) évoqué aussi lors de l’article que j’ai écrit sur le Gimnasia LP.
Tu prends pas Masantonio derrière Bernabé ? Il tient la baraque lors de la Copa 35.
Masantonio il est déjà à ce niveau en 34 ? j’ai un léger doute, pour moi il est plus seconde partie des années 30. En AC, c’est la grosse concurrence: t’as Barrera (Racing) qui plante buts sur buts (c’est le meilleur buteur du championnat cette saison là), Cosso (Velez) brièvement évoqué dans l’article sur Doval, qui enfile les buts, et Zozaya que j’ aurais sélectionné … s’il n’était pas blessé.
Top 4 des buteurs du championnat 34. En phase ascendante mais déjà là avec un Globo pas flamboyant.
Et oui, en 1930, l’Espanyol est en grande difficulté sur le plan financier et ne parvient pas à conserver ses cracks. À l’issue d’un feuilleton qui tient le lectorat espagnol en haleine, Zamora rejoint le Real Madrid à la fin de l’été. José Padrón et Martí Ventolrà, héros de l’Espagne contre l’Angleterre en 1929, acceptent les pesetas du Sevilla FC en seconde division alors que Ricardo Gallart part pour Oviedo où il va participer à composer la delantera eléctrica aux côtés de Lángara.
Scarone, meilleur joueur des années 1920, chose communément admise en Argentine et au Brésil (en tout cas, on le lit fréquemment). Ce qui en dit long sur le talent du bonhomme. Son passage à l’Inter et à Palerme ne sont pas représentatifs de ce qu’il était dans les années 1920 (on peut également imaginer qu’il a pris du bon temps en Italie compte tenu de son caractère).
Chouette série.
En complément audio, en goguette en Uruguay.
https://www.radiocampustours.com/emissions/tsigalko-united-8-un-billet-pour-montevideo/
un groupe uruguayen que j ai kiffé ecouter en amlatine, et que j ecoute toujours, je vous recommande: Cuatro pesos de propiña.
Tout d’abord merci à Bobby pour la série. Très, très crédible. Plutôt que de tenter une uchronie sur 1942 ou 1946, je tenterai plutôt 1950. Avec une France qui accepte d’être repêchée, tout comme l’Ecosse, et soit l’Inde qui peut jouer pieds-nus (ou qui au contraire s’oblige à jouer chaussée)(même si j’ai toujours eu du mal à croire à cette histoire), soit la Sarre qu vient représenter l’Allemagne à peine refédérée…
Sinon, pour Torino et Meroni, je pose ça là
https://www.youtube.com/watch?v=LbqetYgsKtU
C’est un des épisodes de ‘Sfide’, une série présentée par l’ancien pilote, Zanardi, qui date d’il y a une dizaine d’années. Je la trouve bien faite, en dépit d’un côté parfois trop solennel dans les commentaires.
Et tu as raison de douter.
J’ai traité de quelques-uns des forfaits à la Coupe du monde 1950 : https://www.pinte2foot.com/article/abandons-a-la-coupe-du-monde-1950-1-2-la-turquie-lecosse-et-linde
https://www.pinte2foot.com/article/abandons-a-la-coupe-du-monde-1950-2-2-la-france
Merci pour le lien, j’ai raté à peu près tout ce qui s’est publié de fin mars à fin juin malheureusement.
Je sais que la délégation italienne était arrivée exténue parce que, à cause de la catastrophe de Superga, elle était venue en bateau et s’était fracassée d’entrée contre les excellents suédois (champions olympiques et qui avaient rejoint la Serie A à force francs suisses).
C’aurait été sympa, un groupe Uruguay-Bolivie-Turquie-France et un autre Italie-Suède-Paraguay-Inde 🙂
Voici mes équipes pour la coupe du monde 1942
ARGENTINE 1 GUALCO 2SALOMON 3ALBERTI 4SOSA 5PERUCCA 6RAMOS 7 MUNOZ 8 MORENO 9PEDERNERA 10 A SASTRE 11 ENRIQUE GARCIA
URUGUAY 1PAZ 2BERMUDEZ 3MUNIZ 4RODRIGUEZ 5O VARELA 6 GAMBETTA 7PORTA 8CIOCCA 9A GARCIA 10 S VARELA 11 ZAPIRAIN
ITALIE 1 GRIFFANTI 2 FONI 3 RAVA 4 DE PETRINI 5ANDREOLO 6 CAMPATELLI 7BIAVATI 8MEAZZA 9 PIOLA 10 V MAZZOLA 11 P FERRARIS
ANGLETERRE 1 SWIFT 2 SCOTT 3 HARDWICK 4 WILLINGHAM 5 CULLIS 6 MERCER 7 MATTHEWS 8 CARTER 9 LAWTON 10 GOULDEN 11 BROOME
AUTRICHE 1 HIDEN 2 SESTA 3 SCHMAUS 4 URBANEK 5 MOCK 6WAGNER 7 ZISCHEK 8 BICAN 9 BINDER 10 DECKER 11 JERUSALEM
HONGRIE 1 TOTH 2 POLGAR 3 BIRO 4 BELA SAROSI 5 SANDOR SZUCS 6 LAZAR 7 SAS 8 BODOLA 9 GYORGY SAROSI 10 ZJENGELLER 11 M TOTH
ALLEMAGNE 1JAHN 2 JANES 3 MILLER 4 KUPFER 5 ROHDE 6 KITZINGER 7 LEHNER 8 SCHON 9 CONEN 10 F WALTER 11 URBAN
BRESIL 1 CAJU 2 DOMINGOS DA GUIA 3JAU 4 ARGEMIRO 5 BRANDAO 6 AFONSINHO 7 AMORIM 8 ZIZINHO 9 LEONIDAS 10 TIM 11 PATESKO
ESPAGNE 1 MARTORELL 2 TERUEL 3 OCEJA 4GABILONGO 5 GERMAN 6 ZUBIETTA 7EPI 8 MUNDO 9 LANGARA 10 CAMPOS 11 GOROSTIZA
SUEDE 1 BERGQVIST 2 H NILSSON 3 LEANDER 4PERSSON 5 EMANUELSSON 6 GRAHN 7 MARTENSEN 8 GREN 9 NORDHAL 10 CARLSSON 11 NYBERG
FRANCE 1 DARUI 2 VANDOOREN 3MERCIER 4 BOURBOTTE 5 JORDAN 6 DIAGNE 7 ASTON 8 SIMONYI 9 KORANYI 10 BEN BAREK 11 ARNAUDEAU
Voici mes principales équipes pour 1942 ,avec comme principaux favoris L ARGENTINE L URUGUAY L ITALIE LE BRESIL L ANGLETERRE ET LA HONGRIE , avec pour moi une finale ARGENTINE ITALIE ,avec L ARGENTINE VAINQUEUR , etes vous d accord
Chef, propose-nous un article. On le publie.
L’Argentine aurait été en effet favorite.
Bon, pour chipoter sur la Seleção, Jau en 1942, je suis pas convaincu. Vasco est à la ramasse et Jau avec. Mais bon, si tu as besoin d’un prêtre umbanda, pourquoi pas mais je pense que Machado est au-dessus sur cette période. Gardien : pourquoi pas Jurandyr ou Batatais de Flu, lui aussi? Pas de Romeu Pellicciari, dommage.
En 42, pas sûr qu’Atilio García ait la nationalité uruguayenne. Si tu le prends, il faut sacrifier ou Porta, ou Ciocca ou S. Varela car il te faut faire une place pour un ailier droit, Mandrake Castro.
Je ne changerais rien à ton Argentine hormis le vieux Minella à la place de José Ramos.
Pour l’Italie, pourquoi tu ne prends pas Masetti qui pourrait être pour la 3e fois champion du monde, en jouant enfin un match de phase finale ? Griffanti, vraiment quelconque… si tu veux un jeune gardien correct, prends Sentimenti. Au milieu, Loïk a sa place je pense pour son entente avec Mazzola.
Voilà voilà
Faut voir aussi où est organisée cette Coupe du monde.
Si la crise internationale de l’été 1939 s’était finalement dénouée et si la paix avait pu être préservée en Europe jusqu’en 1942 (impensable sans se débarrasser du gouvernement nazi en Allemagne), la FIFA penchait résolument pour le Brésil. Au printemps-été 1939, c’était acté par Rimet.
Une Coupe du monde en Amérique du Sud, les Européens n’y seraient probablement pas à la fête. Et le Brésil, chez lui, serait très motivé.
En revanche, si on part de ma Coupe du monde rêvée, le retour de l’Angleterre dans la FIFA et l’esprit universaliste qui anime alors les sociétés permet d’envisager une Coupe du monde 1934 en Angleterre (c’était vraiment le projet de la FIFA, mais l’Angleterre n’en voulait pas). Les Anglais y seraient-ils champions du monde ?
Ensuite, 1938 devrait logiquement avoir lieu en Argentine. C’était vraiment le concurrent numéro 1 de la France. Et la logique implicite d’alternance des continents aurait dû jouer si la FIFA n’avait pas décidé de confisquer la compétition pour les Européens. Dès lors, Argentine championne du monde ?
Et là, logiquement, 1942 devrait avoir lieu en Europe. Mais où ? Quel scénario ?
Atilio Garcia pas certain qu’il était déjà naturalisé uruguayen en 1942.
Sur la sélection argentine, à ne pas oublier offensivement que Rinaldo Martino, Vicente de la Mata et Rene Pontoni étaient considérés comme parmi les meilleurs à leur poste. Sastre pouvait jouer demi-droit, et c’était un poste où il était utilisé en sélection à cette époque (cf. mon article sur los diablos rojos).
en gardant la même base défensive, perso j’aurais vu Sastre-Perucca-Ramos en milieu; et offensivement: Munoz-Moreno-Pontoni-Martino-Chueco Garcia. Dans les remplaçants en attaque: Pedernera et De la Mata (tous deux utilisés plutôt sur les postes intérieurs), Masantonio (Huracan, avant-centre), Belén (Platense, ailier droit) et Ferreyra (Newell’s, ailier gauche)
Salut Richard. Dans ta sélection espagnole, plutôt qu’un Martorell dans les buts, je mettrais Juan Acuña du Depor. Acuña est le meilleur gardien espagnol de la décennie et il gagne le premier de ses 4 Zamora en 1942. Donc il était déjà au top à ce moment-là.
D’ailleurs Verano a fini par me convaincre. J’avais tendance à placer Ramallets en tant que 5ème meilleur gardien espagnol mais c’est certainement la place de Juan Acuña.
Si la coupe du monde 1946 avait eu lieu ,l’ARGENTINE l’aurait organisé,voici mes principales équipes,
ARGENTINE 1 VACCA 2SALOMON CAP MARANTE 4 CARLOS SOSA 5 PERUCCA 6PESCIA 7 BOY E 8 MORENO 9 PONTONI 10 MARTINO 11 LOUSTAU I 3EMPL PEDERNERA LABRUNA MENDEZ LAZZATTI N ROSSI
URUGUAY 1 MASPOLI 2 RAOUL PINI 3 TEJERA 4 GAMBETTA 5OBDULIO VARELA 6 PRAIS 7LUIS ERNESTO CASTRO 8 WALTER GOMEZ 9 ATILIO GARCIA 10 SEVERINO VARELA 11 ZAPIRAIN REMPL PORTA MEDINA RAOUL SCHIAFFINO VOLPI CIOCCA
BRESIL 1 ARI 2 DA GUIA 3 NORIVAL 4 BIGUA 5 DANILO 6 BAUER 7 TESOURINHA 8 ZIZINHO 9 HELENO DE FREITAS 10 JAIR 11 ADEMIE REMPL LEONIDAS CHICO TIM PERACIO
ITALIE 1SENTIMENTI 2 MAROSO 3 RAVA 4 DE PETRINI 5 PAROLA 6GREZAR 7BIAVATI 8 LOIK 9 PIOLA 10 V MAZZOLA 11 PIERTRO FERRARIS REMPLBACIGALUPO CASTIGLIANO GABETTO
HONGRIE 1 CSIKOS 3BIRO 4NAGYMAROSI 5 SANDOR SZUCS 6 LAKAT 7 SZUSZA 8 ZSENGELLER 9DEAK 10 PUSKAS 11 NYERS REMPL HIDEGKUTTI BELA SAROSI BALOGH LAJOS TOTH
SUEDE 1 SJOBERG 2 H NILSSON 3 ERIC NILSSON 4 ALUND 5 EMANUELSSON 6 GRAHN 7 NYBERG 8 GREN 9 NORDAHL 10 CARLSSON 11 STELLA NILSSON REMPL BERTIL NORDAHL KNUT NORDAHL
AUTRICHE 1 ZEMAN 2 GERNHARDT 3 BORTOLI 4MIKOLASCH 5 SABEDITSCH 6 JOKSCH 7 BICAN 8 DECKER 9 BINDER 10 HAHNEMANN 11 NEUMER REMPL MELCHIOR STROH ALFRED KORNER
ESPAGNE 1 EIZAGUIRRE 2 TERRUEL 3 OCEJA 4ZUBIETTA 5 GERMAN GOMEZ 6IPINA 7 EPI 8 HERRERITA 9 ZARRA 10 CESAR RODRIGUEZ 11 GAINZA REMPL LANGARA CILAUREN SAMPOS IRRAGAGORRI
ANGLETERRE 1 SWIFT 2 SCOTT 3 HARDWICK 4 BILLY WRIGHT 5 FRANKLIN 6 COCKBURN 7 MATTHEWS 8 RAICH CARTER 9 LAWTON 10 MANNION 11 FINNEY REMPL LANGTON MULLEN TAYLOR ROWLEY MORTENSEN
FRANCE 1 DARUI 2 GRILLON 3 SALVA 4 PROUFF 5 CUISSARD 6 LEDUC 7 ASTON 8 HEISSERER 8 BIHEL 10 BEN BAREK 11 VAAST REMPL COURTOIS BONGIORNI MARCHE SWIATEK
DANEMARK 1JENSEN 2 LAURITS 3 BASTRUP 4 HAMMEKEN 5 SORENSEN 6 IVAN JENSEN 7 PLOGER 8 SORENSEN 9 CARLE AAGE PRAEST 10 KARL AAGE HANSEN 11 BRONE
YOUGOSLAVIE1 MONSIDER 2 STANKOVIC 3 BROZOVIC 5 CAJKOVSKI 5 HORVAT 6 SIMONOVSKI 7 TOMASEVIC 8 MITIC 9 BOBEK 10 MATOSIC 11 SIMONOVSKI
POUR cette coupe du monde organisé en ARGENTINE LES FAVORIS SONT 1 ARGENTINE 2 ITALIE 3 HONGRIE 4 BRESIL 5 ANGLETERRE 6 URUGUAY 7SUEDE 8 AUTRICHE
ETES vous d accord avec mes commentaires ,qu en pensez vous , pour moi je vois bien une finale ARGENTINE ITALIE OUTSIDER HONGRIE BRESIL URUGUAY ANGLETERRE
Pour 46, Cozzi dans les buts c’est mieux ! et vu qu’on est dans le fictif, Salomon ne s’est jamais brisé la jambe contre le Brésil en début d’année au Sudamericano (de toute façon avec un Mondial il y aura jamais eu cette compet’ en début d’année) et donc oui, il est là. Mais avec Oscar Basso à la place de Marante pour faire la paire de défenseurs, préférence au défenseur de San Lorenzo qui est en feu comme le Ciclon.
Nestor Rossi plutôt que Perucca (qui avait décliné et perdu sa place déjà ), Pescia ou Colombo (San Lorenzo) à gauche…
Et devant Pedernera titulaire à la place de Moreno, ce dernier était déjà perdu dans les cabarets de Buenos Aires après la chute de la Maquina et partit chercher de l’or au Mexique…
Et d’accord sur les 4 autres: Boyé, Pontoni, Martino et Loustau = aucun doute pour ces 4 là !
(et en remplaçants, de droite à gauche: Cervino (Independiente), Farro (San Lo) Tucho Mendez (Huracan), Labruna (River), Sued (Racing)
Vous avez raison le joueur ATILIO GARCIA a du attendre 1945 pour obtenir un passeport uruguayen en raison de diverses formalités administratives,entre- temps il refusa a plusieurs reprises de jouer pour l ARGENTINE. Il joua pour l equipe d’URUGUAY pour la copa america de 1945
Salut BOBY pourquoi pas organiser la coupe du monde de tous les temps avec les 16 meilleurs équipes ,les 8 vainqueurs de la coupe du monde BRESIL ALLEMAGNE ITALIE ARGENTINE FRANCE URUGUAY ESPAGNE ANGLETERRE ,les meilleurs finalistes HONGRIE PAYS BAS SUEDE TCHECOSLOVAQUIE YOUGOSLAVIE (CROATIE) et pour compléter PORTUGUAL URSS AUTRICHE .
LES POULES :POULE A BRESIL ANGLETERRE PAYS BAS AUTRICHE
POULE B ALLEMAGNE ESPAGNE HONGRIE URSS
POULE C ITALIE URUGUAY TCH2COSLOVAQUIE PORTUGAL
POULE D ARGENTINE FRANCE SUEDE YOUGOSLAVIE
Maintenant révons un peu poule a LE BRESIL avec PELE RONALDO GARRINCHA DIDI ZICO,L ANGLETERRE AVEC MATTHEWS B CHARLTON FINNEY MOORE,les PAYS BAS avec CRUYF VAN BASTEN GULLIT RIJKAARD KROL,lAUTRICHE avec SINDELAR BICAN PROHASKA OCWIRK HANAPPI
Pour moi dans cette poule 1 BRESIL 2 PAYS BAS 3 AUTRICHE 4 ANGLETERRE
POULE B L ALLEMAGNE avec BECKENBAUER NETZER MULLER F WALTER MATTHAUS RUMMENIGE, L ESPAGNE aves SUAREZ GENTO INIESTA XAVI,
LA HONGRIE avec PUSKAS KUBALA KOCSIS CZIBOR SAROSI ALBERT BOSZIK,L URSS avec BLOCKINE CHEVCHENKO YACHINE STRELZOV
Pour moi dans la poule b 1 HONGRIE 2 ALLEMAGNE 3 ESPAGNE 4 URSS
POULE C L ITALIE avec VALENTINO MAZZOLA MEAZZA SANDRO MAZZOLA BAGGIO RIVERA BARESI MALDINI, L URUGUAY avec NAZAZZI SCARONE SCHIAFFINO ANDRADE FRANCESCOLI SEVERINO VARELA, LA TCHECOSLOVAQUIE avec PLANICKA MASOPUST NEDVED PUC NEJEDLY,LE PORTUGAL avec C RONALDO EUSEBIO FIGO RUI COSTA COLUNA,Pour moi dans cette poule 1ITALIE 2 URUGUAY3 PORTUGAL 4 TCHECOSLOVAQUIE
POULE D L ARGENTINE avec MARADONA MESSI DI STEPHANO MORENO PEDERNERA PASSARELLA,LA FRANCE avec KOPA PLATINI ZIDANE HENRY M BAPPE FONTAINE,LA SUEDE avec NORDHAL GREN LIEDHOLM IBRAHIMOVIC HAMRIN SKOGLUND,LA YOUGOSLAVIE avec MODRIC DZAJIC SEKULARAC BOBBEK VUKAS STOJKOVIC
,Pour les QUARTS DE FINALE ,VOICI LE TIRAGE AU SORT
BRESIL FRANCE ARGENTINE PAYS BAS HONGRIE URUGUAY ALLEMAGNE ITALIE
Qualifiés pour LES DEMIS FINALES BRESIL ARGENTINE HONGRIE ITALIE
Tirage au sort DEMIS FINALE BRESIL ITALIE ET ARGENTINE HONGRIE
Qualifié pour la grande finale BRESIL CONTRE ARGENTINE
Match pour la 3eme place HONGRIE ITALIE vainqueur LA HONGRIE
POUR la grande finale entre L ARGENTINE ET LE BRESIL
Le VAINQUEUR EST L ARGENTINE DE MARADONA MESSI DI STEPHANO
A l issue du temps réglementaire le score était de 3 partout ,buts pour L ARGENTINE DE DISTEPHANO MESSI ET MARADONA pour LE BRESIL 2 buts de RONALDO et 1 DE PELE
APRES PROLONGATION score de 5 à 4 pour l ARGENTINE ,les buts furent marqués par GARRINCHA ET Pour L ARGENTINE DI STEPHANO ET MARADONA aprés avoir dribblé 4 joueurs bresiliens
J attends vos commentaires ,que pensez vous de cette idée
On attend ton article, RICHARD !
Avec moins de majuscules, si possible…
B onjour savez vous pourquoi LUDOVICO BIDOGLIO n’a pas participé à la coupe du monde 1930 ,alors qu il a été champion avec boca en 1930 et formait avec MUTTIS une défense redoutable,il était le meilleur défenseur argentin
Meme question pour MANUEL SEOANE et TARASCONI merci de vos réponses
Pour Tarasconi, c’est une grave blessure au genou qui le prive du Mondial.
D’ailleurs je l’avais mentionné dans mon Top 50 Boca Juniors que j’ai publié l’an dernier, il y a pas mal de portrait des joueurs de la période 20-30-40 de Boca, si le sujet t’intéresse jettes-y un oeil.
Pour Bidoglio, ça reste un mystère… j’ai l’impression qu’il a mis fin à sa carrière internationale après les JO, il n’est plus appelé après 1928, mais c’est mentionné nulle part…. ou alors un choix du sélectionneur ? au mondial 30 c’est Olazar une légende du Racing des années 1910 qui privilégie la paire racinguista Della Torre – Paternoster … (Paternoster était déjà titulaire en 28 avec Bidoglio, Muttis est remplaçant en 30.) Mais Bidoglio reste hyper performant à Boca. j’ai déjà cherché la raison, mais jamais trouvé de sources qui la donne…
Pour Seoane, j’avais lu que c’était une question familiale et économique, il voulait pas s’absenter trop longtemps et pas de prise en charge de sa famille durant sa potentielle absence, un truc du genre.
On est aux balbutiements du foot pro, il y a plusieurs grandes figures du foot « amateur » qui reste sur le carreau en 1930, un peu un tournant de ce point de vue là, la fin d’une époque, le début d’une autre.
En 1930 l’équipe du BRESIL n était représenté que par des joueurs cariocas,il est dommage que des joueurs comme FRIEDENREICH FEITICO PETRONILHO DE BRITO FILLO GUARISI n ont pus participés à la coupe du monde ,pensez vous qu avec ses joueurs le BRESIL AURAIT PU BATTRE L ARGENTINE ET L URUGUAY
Non.
Le foot rioplatense me semble trop en avance, alors, sur l’ensemble de la planète.